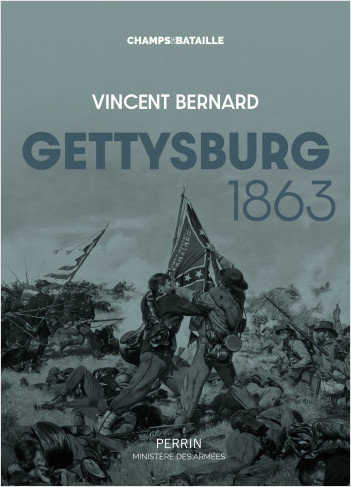Gettysburg. Pour l’éternité, le nom est associé à la bataille qui s’est déroulée dans cette bourgade pennsylvanienne de moins de 10 000 habitants au Nord de Washington, D.C. Chaque année, près d’un million de touristes foulent le sol de ce lieu sacré où une « scintillante forêt de baïonnettes » s’engagera au combat durant trois journées fatidiques, du 1er au 3 juillet 1863.
À écouter certains guides et plusieurs historiens, cette bataille fut un point tournant de la guerre de Sécession. Il n’en fut rien. Au soir du dernier jour de la bataille, « rien ne change fondamentalement sur le théâtre d’opérations principal » relate l’historien Vincent Bernard dans le Gettysburg 1863 (Perrin) qu’il consacre à ce moment fort dans l’histoire des États-Unis. Les tuniques grises rassemblées sous le commandement du général Robert E. Lee n’est pas en déroute. Loin d’être effondrée, elle continuera de tirer son épingle du jeu pendant encore près de deux ans.
L’intérêt envers cette bataille n’est pas près de s’estomper. Le discours légendaire qui y fut prononcé quelques mois plus tard par le président Abraham Lincoln a incontestablement contribué à son entrée dans la postérité, puisqu’il fait écho au lourd tribut de sang, de sueur et de larmes consentis par les deux armées en ces journées estivales.
Dans son explication minutieuse et accessible des différentes phases de la bataille, Vincent Bernard brosse le tableau d’un moment intense de bravoure, durant lequel les esprits trempés des combattants et des commandants bravèrent le brouillard de la guerre. Au-delà des opérations, l’auteur excelle dans l’évocation du caractère et de la contribution des principaux pugilistes.
Côté nordiste, il évoque le général de cavalerie John Buford, « un ombrageux Kentuckien de 37 ans aux longues moustaches reconnaissables ». On se délecte aussi de lire à propos de George Armstrong Custer, un « tout jeune brigadier-général de 23 ans […], bon dernier de sa promotion et recordman de blâmes (726) à West Point mais dont le caractère de tête brûlée et le sens tactique correspondent exactement aux besoins de la cavalerie, ce qui lui a permis de gravir rapidement les échelons. » Quant aux férus de baseball, ils seront heureux d’apprendre que ce sport a été inventé par un major général nordiste, Abner Doubleday, lequel était également présent sur le champ de bataille.
Du côté des tuniques grises, on fait connaissance avec James Longstreet, personnage « controversé de temps à autre pour son calme olympien passant parfois pour de l’apathie et sa réputation d’arriver tard sur le champ de bataille, il est solide, loyal et très lié à Lee […]. » L’historien – qui est aussi l’auteur de deux grandes biographies consacrées à Ulysses S. Grant et Robert E. Lee – n’en est visiblement pas à ses premières armes. À propos du second, il cite le commentaire admiratif dulieutenant-colonel anglais Arthur Fremantle, à propos du commandant sudiste :
« Il n’a aucun des petits vices, tels que fumer, boire, chiquer ou jurer, et son pire ennemi ne l’a jamais accusé des plus grands. Il porte généralement une longue veste grise, un haut chapeau de feutre noir, et un pantalon bleu rentré dans ses bottes Wellington. »
Au-delà du moral et des sacrifices consentis par les troupiers, la conduite des opérations dépend des officiers supérieurs. En ce sens, le fardeau de l’incursion sudiste en Pennsylvanie repose sur les épaules du chef de guerre sudiste. Rien de plus naturel, puisqu’il en est l’initiateur me direz-vous.
Comme tout praticien de l’art militaire, Lee doit se frotter à la friction de la guerre. Atteint accidentellement par une balle amie à la bataille de Chancellorsville, le vénéré Stonewall Jackson succombe à ses blessures et n’est plus là pour seconder son chef. La fonction de numéro deux est maintenant occupée par le général James Longstreet, figure moins affirmée sur le champ de bataille. Des suites de ses hésitations et de ses prises de position après-guerre, plusieurs feront porter sur lui le fardeau de la défaite. Mais c’est un autre débat.
Lee est aussi aveuglé par l’absence de renseignements de la part de la cavalerie du flamboyant général Jeb Stuart, le « privant de ses yeux et de ses oreilles au moment d’engager la bataille. » Celui qui est le plus célèbre cavalier de la confédération semblait davantage préoccupé de laver l’affront subi aux mains des cavaliers nordistes qui l’ont pris par surprise à Brandy Station au mois de juin. L’absence d’ordres écrits transmis par Lee ajoute au tableau et contribue aux problèmes de coordination, aux délais et aux hésitations. L’interception d’un ordre écrit en septembre 1862 avait « manqué de faire détruire toute son armée à Antietam. » On n’y reprendra pas le renard gris. Mais cette décision a un prix…
Devant les assauts sudistes homériques – je pense ici notamment à la légendaire charge de Pickett (mal nommée selon le verdict de l’auteur) – se dressent les troupes nordistes placées sur la défensive. Bien qu’en proie à de nombreux changements (ils seront cinq généraux à se succéder à la tête des tuniques bleues), leur commandement « conserve […] son sang-froid et joue admirablement de ses réserves disponibles, faisant régulièrement relever les unités fléchissantes par des troupes reposées sinon fraîches. »
Au soir du 3 juillet, le Nord n’avait pas fléchi, Lee n’était pas vaincu. Les faits d’armes qui caractérisent ces heures d’affrontements déchirants entre frères étaient appelées à occuper certaines des pages les plus glorieuses de l’histoire des États-Unis.
J’ai eu le privilège de parcourir le champ de bataille de Gettysburg à quelques reprises et j’ai toujours souhaité mieux comprendre ce qui s’y est passé et ceux qui s’y sont démarqués. L’un des plus grands mérites du livre de Vincent Bernard est de permettre au lectorat francophone de mieux saisir la perspective et les protagonistes sudistes dans cette bataille iconique, tout en démêlant l’histoire de la légende.
En prime, c’est diablement bien écrit.
_____
Vincent Bernard, Gettysburg 1863, Paris, Perrin, 2023, 2023, 320 pages.