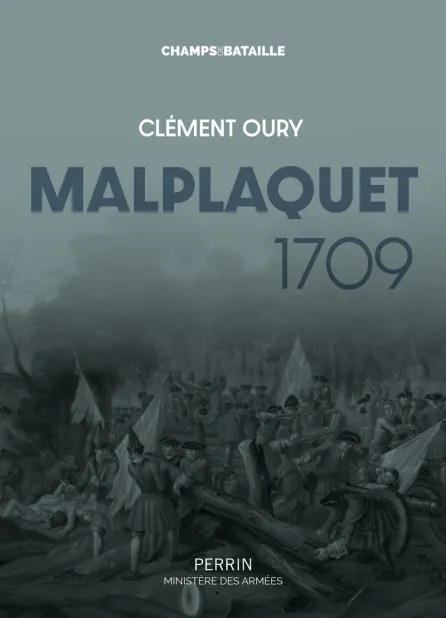Louis XIV aurait souhaité la baptiser autrement, mais la postérité l’a consacrée sous le nom de bataille de Malplaquet. « Donner un nom, c’est donner un sens », écrit l’historien Clément Oury, qui lui dédie un ouvrage incomparable, Malplaquet 1709, dans la collection « Champs de Bataille », dirigée par Jean Lopez aux Éditions Perrin. D’entrée de jeu, un constat s’impose : du début à la fin, cette échauffourée défie toute logique.
Au cœur de la Guerre de Succession d’Espagne, la France de Louis XIV doit braver l’hiver 1708, lequel réclame un lourd tribut à une population déjà aux prises avec une économie plombée. Croyant le Roi-Soleil dans les câbles, les Alliés présentent un chapelet de demandes exigeantes et intransigeantes, notamment qu’il retourne « ses armes contre son petit-fils », Philippe d’Anjou, ce que le souverain ne peut accepter. Les opérations militaires reprennent de plus belle. Elles sont dirigées par le prince Eugène de Savoie et le duc de Marlborough – l’ancêtre de Winston Churchill, dont le Vieux Lion contribuera à nourrir la mémoire. La forteresse de Tournai est prise, question de « contraindre Louis XIV à une paix rapide, et en tout cas l’humilier en prouvant qu’il n’est plus en mesure de défendre ses propres peuples. » Relevant le gant, celui-ci enjoint aux maréchaux de Villars et de Boufflers de faire sonner le tocsin pour défendre le royaume.
Le 11 septembre 1709, c’est donc au sud de Mons que la partie se jouera. Les armées qui s’affrontent « […] avaient atteint des dimensions jamais vues dans l’histoire moderne […] ». Sur le flanc droit du champ de bataille, les Hollandais essuient une cuisante défaite, tandis que Boufflers, bien qu’en position d’agir, choisit l’immobilité : « Le vieux maréchal préfère s’en tenir aux ordres qu’il a reçus, et reste sur la défensive. » Une décision lourde de conséquences pour lui.
La bataille, qui s’étend sur sept heures, est rythmée par une série d’épisodes successifs. Elle atteint son point culminant lorsque « l’offensive alliée au centre du champ de bataille [qui] est menée par les bataillons de lord Orkney » – un lieutenant-général écossais — est lancée. « En quelques dizaines de minutes, le centre du dispositif français vient d’être éventré […]. »
Dans de telles circonstances, la déconfiture française devrait logiquement se solder par une défaite cuisante pour Louis XIV. Pourtant, le roi parvient, contre toute attente, à défier le sort des armes. Comment expliquer ce revirement de situation ?
Tout d’abord, parce que la retraite française se déroule de manière ordonnée et courageuse. Eugène et Marlborough n’ont pas réussi à achever un adversaire en déroute, mais combatif. Pour tout dire, la « comptabilité macabre » des combats se règle au prix d’« un désastre pour les Alliés ».
Vient ensuite la joute du verbe et de la mémoire, moins frontale mais plus incisive encore. Durant l’affrontement, Villars est immobilisé par une balle qui lui fracasse le genou. Il quitte le champ de bataille en faisant montre d’un sens du spectacle, témoignant qu’il ne s’en laisse pas imposer. Au contraire, cette posture rehausse son prestige auprès du roi, contrairement à un Boufflers dépourvu d’habileté politique et de talent pour l’autopromotion.
Toute défaite, nous rappelle Clément Oury, réclame toutefois un coupable. Ce sera donc le second qui écopera. « Après tout, on peut légitimement lui reprocher de ne pas avoir contre-attaqué sur l’aile droite, après l’échec des Hollandais ». À cet égard, l’historien partage avec le lecteur une leçon qui vaut autant dans le métier des armes que dans la vie quotidienne : « Un général, écrit Clément Oury, a toujours d’excellentes raisons de ne pas agir. L’inaction peut éviter un désastre ; mais elle apporte rarement des succès tangibles. »
Qu’à cela ne tienne, le grand vainqueur de Malplaquet, c’est Louis XIV. Faisant preuve d’un sens stratégique admirable, il entretient le mythe d’une bataille victorieuse en récompensant Villars, ce qui contribue à semer la discorde dans le camp ennemi. Dans un climat de lassitude face à la guerre, et porté par la victoire électorale en août 1710 du parti tory – lequel est farouchement opposé à Marlborough – le Roi-Soleil se retrouve en excellente position pour entamer des négociations secrètes avec les Britanniques. Londres a en effet décidé de faire cavalier seul pour mettre fin aux hostilités. La messe est dite : Louis XIV a remporté son pari. Il conserve les territoires conquis depuis le début de son règne, et un Bourbon ceint toujours la couronne d’Espagne. On devine le soulagement dans les couloirs de Versailles. La déroute des troupes françaises s’est ainsi muée en victoire. La politique, pourrait-on dire, peut se révéler être la poursuite de la guerre par d’autres moyens.
La lecture de l’histoire-bataille s’avère parfois un exercice ardu. Sans rien sacrifier à la précision militaire, Clément Oury brosse un portrait captivant de la geste guerrière et des figures qui en ont jadis porté les armes. Sa description de la personnalité de Marlborough et des talents de solliciteur de récompenses de Villars – notamment auprès de Madame de Maintenon, l’épouse secrète de Louis XIV – illustre avec brio l’un des ressorts les plus profondément humains de l’action : la quête de reconnaissance. Une capacité fine à mesurer l’impact des tempéraments dans la conduite des affaires militaires n’est pas la moindre des qualités d’un historien militaire qui compte parmi les meilleurs.
_____
Clément Oury, Malplaquet 1709, Paris, Éditions Perrin, 2024, 368 pages.