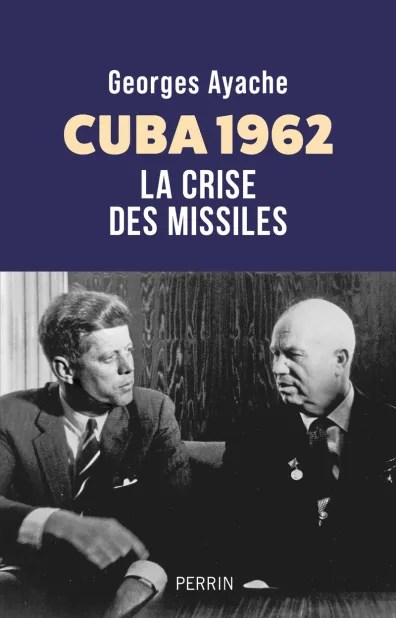Les 3 et 4 juin 1961, John F. Kennedy rencontre pour la première fois son vis-à-vis soviétique Nikita Khrouchtchev à Vienne. Ce sommet ne se déroule pas sous les meilleurs auspices pour celui qui occupe la Maison-Blanche depuis moins de six mois. Quelques semaines plus tard, dans la nuit du 12 au 13 août, le Mur de Berlin sort de terre sur ordre de Moscou. De ces deux épisodes, le maître des horloges du Kremlin pouvait déduire « qu’il avait décidément affaire à un interlocuteur pouvant être intimidé à peu de frais. Et que l’installation de missiles soviétiques à Cuba ne provoquerait pas de réaction à la Maison-Blanche qui se résignerait sans doute, mise face au fait accompli », pour citer l’observation de Georges Ayache dans son dernier livre Cuba 1962 – La crise des missiles (Éditions Perrin).
Au-delà de l’affrontement géopolitique, la crise des missiles se veut un choc générationnel. 23 ans séparent les deux protagonistes. En comparaison avec le tempérament remuant de l’ancien séide de Staline, le chef de file du Parti démocrate affiche une santé des plus précaires. À cet égard, l’auteur évoque la présence dans l’entourage présidentiel immédiat du « responsable du fameux sac en cuir brun marqué « effets personnels du président » qui contenait les médicaments à tenir en permanence à la disposition de JFK en dehors du bureau Ovale. » On en dénombrait une dizaine… Il est donc aisé de le mésestimer. Mais le 35e président a été blanchi sous le harnais des épreuves.
Tout au long de cet affrontement de 13 jours qui aura conduit le monde au bord du précipice nucléaire, l’ancien sénateur du Massachusetts aura accepté de relever le gant face à deux adversaires coriaces. Tout d’abord, Khrouchtchev et le régime de son affidé cubain, Fidel Castro, mais aussi son propre cabinet à l’intérieur duquel le président est clairement méjugé. À commencer par son vice-président, Lyndon B. Johnson, qui fait preuve d’un talent politique légendaire mais qui ne se démarque certainement pas par un excès de loyauté envers celui à qui il devait son poste. Même attitude du côté de l’ancien secrétaire d’État Dean Acheson, un poids lourd qui ne tient pas la famille Kennedy en odeur de sainteté. Dans le camp des va-t-en-guerre, il ne faudrait surtout pas omettre la présence des militaires. Exemple éloquent, le général Curtis LeMay, patron de l’US Air Force. Cet « officier rugueux […] porté vers la confrontation » ne rechigne pas à afficher son insolence devant son commandant-en-chef. La prudence du chef de l’Exécutif se rapprocherait de cet esprit de Munich qui avait ouvert la brèche au péril nazi à l’orée de la Seconde Guerre mondiale. Minoritaires dans leur propre camp, JFK et son frère auraient même envisagé la possibilité d’un coup d’État ourdi de l’intérieur.
« Mieux que d’autres sans doute, Kennedy savait qu’il peut être très dangereux d’acculer un adversaire dans les cordes en lui faisant perdre la face, surtout s’il est imprévisible », constate Georges Ayache. Le président est très conscient que tout dérapage pourrait, dans le pire scénario, conduire à l’Apocalypse, ou encore se répercuter à Berlin, cet avant-poste occidental au cœur de l’empire rouge. Et il y a l’état d’esprit qui règne derrière les murailles du Kremlin. Les dirigeants soviétiques sont apeurés, déstabilisés, exténués. Khrouchtchev « ne voulait pas la guerre » et la situation semblait se soustraire à sa volonté. Exit donc, l’option militaire. Avec la promesse de ne pas envahir Cuba et de retirer les missiles Jupiter – de toute manière désuets – de la Turquie, le talent d’équilibriste de JFK sera payé de succès.
Certains passages du livre donnent même l’impression d’être au cœur d’un roman d’Ian Fleming, père de James Bond et auteur très prisé par JFK dont le nihil obstat lui sera précieux. C’est ainsi que l’on apprend, grâce aux mémoires de Robert F. Kennedy Jr. (actuel secrétaire à la Santé dans l’administration Trump) qu’un espion soviétique, Georgi Bolshakov, est devenu un habitué de Hickory Hill, résidence qui servait de sanctuaire à la famille du solliciteur général et frère cadet du président. Mise à mal par les mensonges de Moscou à propos de la présence des missiles nucléaires au large de la Floride, cette relation contribua à la sortie de crise.
Cuba 1962 répond brillamment aux attentes du lecteur souhaitant comprendre les tenants et aboutissants d’un moment clé de la guerre froide. Ne serait-ce qu’à cet égard, le livre est un pari amplement réussi. Mais il y a plus. D’une plume aiguisée, George Ayache n’hésite jamais à exposer les failles et faiblesses de celui qui repose pour l’éternité au cimetière national d’Arlington. On peut notamment le constater au fil de son précédent ouvrage sur l’élection présidentielle de 1960. Son jugement sur la gestion de la crise d’octobre 1962 n’en est donc que plus porteur. « JFK ne se dérobait jamais pour peu que son courage physique soit mis à l’épreuve », écrit-il en conclusion.
Ça me rappelle le dialogue entre Q et James Bond dans Skyfall devant le tableau The Fighting Temeraire au National Portrait Gallery à Londres. « De temps en temps, il faut bien appuyer sur la gâchette », déclare le premier. Ce à quoi le second répond : « Ou pas ». Dans la fresque présentée par Georges Ayache, un seul homme aura su et voulu résister aux appels de Mars, dieu de la guerre, invité dans cet épisode de l’histoire contemporaine par les erreurs d’appréciation d’un dirigeant soviétique en mal de considération, et indirectement soutenu par la posture des faucons de Washington, prêts à déployer leurs ailes. À elle seule, cette raison suffit à justifier que le 35ᵉ président soit rangé parmi les grands, et que l’ouvrage qui retrace son attitude face au péril s’impose comme une référence incontournable dans toute réflexion sur la stature présidentielle.
L’un de mes livres favoris de 2025!
_____
Georges Ayache, Cuba 1962 – La crise des missiles, Paris, Éditions Perrin, 2025, 416 pages.